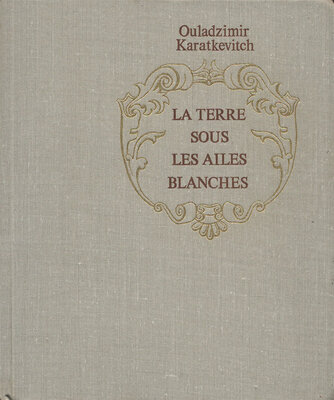La terre sous les ailes blanches
Уладзімір Караткевіч
Выдавец: Юнацтва
Памер: 207с.
Мінск 1981
Dès que la rançon est perçue l’obstacle disparaît en moins de cinq minutes, laissant passer le cortège couvert de fleurs et de rubans multicolores. Pendant l’assaut de la barricade, les cavaliers accompagnant les mariés tiraient des coups de fusil en l’air. Pas contre un mauvais oeil, comme
autrefois, mais tout simplement pour ajouter du ton à l’ambiance générale.
Le convoi volait alors à une vitesse folle.
La noce a duré trois jours chez le marié, ensuite elle a été prolongée chez les parents (oncles et tantes) des deux côtés, pour que les gens n’en disent pas du mal.
Et tout le temps on n’entendait que des chansons, des chansons partout, des tristes et des gaillardes. Et il faut dire que pas une ne s’est répétée durant toute la noce.
Et voilà que commence la vie conjugale de la mariée. Dans le coffre on empile certaines de ses affaires, des choses du mari et des autres membres de la famille, on y place un lourd morceau de bure pour le zipoune du mari (manteau de paysan). On ne place dans le coffre que des vêtements d’homme de ce genre, sans compter les ceintures. Les habits masculins étaient cachés ailleurs ou pendaient à part. Les chemises du mari étaient un peu moins brodées, les pantalons se taillaient dans la toile pour l’été; ils étaient de bure pour l’hiver. Les chemises n’étaient brodées que par le devant, à l’encolure et aux manchettes, en bas sur l’ourlet et un peu sur les épaules aux coutures. Le gilet, ,,la camiselka”, comme on l’appelait, faisait aussi partie de l’ensemble pour homme.
Il est clair, que les survêtements d’hommes et de femmes n’étaient pas entassés dans le coffre, il est question de toutes sortes de manteaux de peau de mouton (souvent brodés aussi), des bottes, faites de feutre épais comme le doigt, des longs manteaux avec capuchon pour la route d’hiver, des zipounes (qu’on appelait “latoukha”, “ciarmaga”, ,,soukmann”, “joupann” selon la région) de couleurs variées, mais blancs bien souvent avec des bandes de laine rouge cousues dessus (dans la région de Gomel), embellis de tresses bleues (dans la région de Bykhov), de tresses vertes ou de bandes étroites de peau noire (dans celle de Klimovitchi). Voilà pourquoi une foule de paysans ressemblait toujours à une immense tache blanche.
Evidemment, on ne gardait pas non plus dans les coffres les chapeaux de feutre, les “maguerkis” comme on les appelait (un cône tronqué au bord retourné), les coiffes de peaux, les “ablavoukhi” ou les “ragatovki”, faites de peau de mouton à laine blanche. Il en était de même pour les chaussures: les laptis taillés dans un seul morceau de cuir ou tressés de bandes de cuir de couleurs différentes ou encore d’écorce de tilleuls (les laptis étaient très commodes par temps pluvieux ou pendant la fenaison sur les marais: l’eau s’écoulait facilement, le pied était à l’aise, rien à dire, c’était pratique et cela ne coûtait rien), les tcharavitchki (chaussures légères de box-calf qu’on ne mettait que pour aller à la messe), les bottes de cuir.
Les ceintures, elles, n’étaient gardées que dans les coffres. Elles étaient tressées ou tissées en points d’épine ou en losanges, en abeilles, toujours de deux ou plussieurs couleurs, il y en avait de larges et d’étroites.
La ceinture faisait plusieurs fois le tour de la taille,les extrémités se terminaient par des glands.
La ceinture bleue, elle est de ma mère,
La rouge, la vive, celle de mon mari,
Et celle là, la belle, la longue avec des franges, Pour les jours de fête parfois la mettait mon oncle. Et les flûtes chantèrent, les guslis aussi, Voilà mon frère parti danser, les franges
de sa ceinture voler...
La baboulia de sa manche sécha une larme, Car son frère, le seul, de la guerre n’est pas rentré. Une autre ceinture, une large, bien pliée en deux, Par le mari de la baboulia autrefois était portée. Elle serait bien à la taille d’un hobereau, Mais pas tissée à Sloutsk elle n’en fait pas l’affaire.
La ceinture devenue coutume n’est pas née des riches. Faite à la campagne, elle leur plut avant. Avant celle tissée à Sloutsk, bien avant encore. Depuis le riche propriétaire porte la ceinture à la villageoise.
A côté des ceintures dans le coffre il y avait un endroit spécial pour les parures. On y plaçait là la bague de fiançailles qu’on retirait celles-ci passées, car elle gênait pendant les travaux; les colliers, parfois de vrai corail d’ambre ou de grenat, des colliers de perles ou tout simplement de verre. Au fait, les grains de verre n’étaient pas populaires du tout en Biélorussie.
Il y avait là aussi évidemment des boucles d’oreilles de rechange. Des boucles d’oreilles, tout le monde en portait. On perçait les lobules à l’âge de sept ans, on y passait à l’aide d’une aiguille un morceau de fil de lin qu’on laissait un certain temps, les plaies étaient lavées à l’eau de vie ou bien mieux avec du lait de nourrice.
Les jeunes filles, comme partout, se faisaient des couronnes et des colliers de fleurs de nénuphar, enfilaient des tiges vertes, laissant une fleur en bas. Elles faisaient et font aujourd’hui aussi des colliers avec des fruits d’aubépine, de sorbier, d’églantier ou d’obier.
Venait enfin dans le coffre une espèce de tiroir sous lequel on rengeait un tablier, un anedarak (une jupe), une chemise, une paire de chaussures, un fichu. C’était le dernier habit, l’habit de la morte.
Et l’homme, avec ce même calme philosophique qu’il a sur l’idée de la mort, avec cette même simplicité avec laquelle il fait le travail le plus ordinaire et le plus nécessaire sur terre, il prépare de son vivant ce qu’il lui faudra pour mourir, pour “ne rien demander aux autres”. Il mettra même de l’argent de côté, de l’argent qui servira à tout: aux funérailles, aux repas de deuil; on en dira que du bien.
Et puis, n’en parlons plus. Si, ajoutons que dans certains endroits, on place dans le cercueil l’objet le plus aimé du mort: s’il avait été musicien, on y place à côté son violon; pour le charpentier ça sera la hache. On met parfois aussi dans le cercueil une pièce de monnaie pour que le défunt puisse “acheter” une place, du pain,
du sel et de l’eau de vie. On y croit plus depuis longtemps, mais la coutume est restée, d’ailleurs, elle n’est pas toujours respectée.
Il y a encore une chose assez particulière, ce sont les pleurs de femmes. Elles se lamentent à tour de rôle. L’une commence, une deuxième reprend pour être remplacée par une troisième.
Elles pleurent partout: à la maison, chemin faisant, au cimetière. La femme pleure son mari, la fille la mort de sa mère, la mère celle de sa fille. On pleure son chagrin et celui de la famille, le chagrin des voisins, on rappelle les bonnes habitudes qu’avait le défunt de son vivant. Il n’y avait pas de pleureuses toutes prêtes. Les pleurs, ça ne se prépare pas à l’avance, où serait alors le côté tragique de la mort? L’insupportable peine est versée sur le champ, sans aucune préparation, il n’y a que le canevas qui existe, le fil à suivre avec quelques éléments généraux; et c’est sur ce canevas que la pleureuse ,,brode” ses lamentations. Là, tout dépend alors de son talent, du côté poétique de la femme, de son imagination et de son coeur, de ce qu’elle peut ressentir.
...Il y a quelques années, nous avons tourné un film sur les victimes du fascisme.
Dans la région de Moguilev il y a eu un village entièrement brûlé avec ses habitants par une expédition punitive. Les os calcinés reposent dans une fosse commune. La place est marquée par un obélisque. Une femme arrive d’un village voisin, une femme qui n’avait personne dans la fosse commune. Tout à coup elle se saisit la tête et se met à marcher en trébuchant autour de l’obélisque en se lamentant. Les clameurs nous ont fait froid dans le dos, les cheveux se sont dressés sur nos têtes. On avait du mal à retenir nos larmes. Ce morceau de film n’a pas été montré sur l’écran, on ne nous aurait pas cru, on nous aurait dit “que la scène a été jouée par une vedette”. Alors que nous avions été en présence d’une pleureuse extraordinaire qui avait su se pénétrer de
chagrin à s’en serrer le coeur et à briser celui des autres par ses lamentations. Voilà pourquoi chaque pleureuse est unique en son genre.
Voilà par exemple les paroles d’une femme pleurant la mort de son mari, des paroles que j'ai recueillies exprès. Ces lamentations ne se répéteront nulle part.
Je t’ai suivi jusqu’au bout du monde, Je t’ai suivi jusque dans les flammes. Mon homme chéri!
Bien aimé!
Il arrivait de me lever à l’aube, Mon homme chéri dans les champs déjà marchait.
Sa présence faisait épanouir les fleurs, Et briller le ciel.
A le regarder—
tout semblait léger comme des papillons.
A le regarder —
tout semblait fleurir comme le blanc poirier A le regarder —
il était doux comme la feuille d’érable.
A le regarder —
le coeur se mettait à battre...
Que la vie est dure
sans toi, mon ami chéri...
Je vais me laisser choir sur ta tombe
Pour laisser couler mes larmes, comme le fait l’oiseau en pleur.
Mon ami bien cher, pourquoi donc-m’as-tu quittée? Etais-tu mal traité de tes enfants, ou de ta femme?
Qui nous aidera maintenant...
dans la vie?
Comment allons-nous vivre...
sans toi?
Comment pourrons-nous...
t’oublier?
Où aller maintenant... t’attendre?
Qui pourrai-je maintenant la nuit . de mes bras enlacer?
Qui maintenant de bons conseils pourra me donner?
Ainsi arrive la fin.
Où a-t-il été enseveli?
Comme l’a voulu la baboulia: la vie de laquelle est liée et le restera à la terre.
Assez loin, en face du village, sur un monticule de sable le bouleau avec hommage baisse ses branches.
C’est là pour le sommeil éternel Que s’est rassemblé le village, sous des croix, sans souci, ils reposent sous des tertres. Les dalles de pierre ne leur font aucun mal, leur mémoire et leur gloire par leurs fils sont transmises.
Le couvercle du coffre se ferme à jamais.
PRÈS DE LA MAISON
DANS LE VERGER
Je répète encore une fois qu’une grande partie de tout ce qui a été raconté sur les pages du livre (les coutumes, les habitudes, l’ethnographie) est depuis longtemps oubliée, restée dans le passé, devenue vestige et si quelque chose est resté, ce quelque chose n’est gardé que dans certaines régions. La maison, la cour, l’ameublement se ressemblent de plus en plus. Il y a longtemps qu’on a l’habitude du réfrigidaire, de la machine à laver, de la voiture ou de la moto. Le gaz est arrivé dans les maisons. Les antennes de télévision surmontent les toits. Tout cela fait plaisir à voir, mais parfois il serait bien de garder un brin du passé, de ce passé qui provoque un désir irrésistible de revoir la vieille maison villageoise, que ça soit
 КНІГІ ОНЛАЙН
КНІГІ ОНЛАЙН